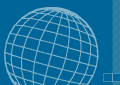Conférences organisées
par le département Information - Communication
Université Rennes
2 Haute Bretagne
Conférences universitaires
Responsable : Mme Catherine Loneux
 1999-2000
1999-2000
Invités:
D.Bougnoux
B.Floris
F.Mispelblom
Ph.Breton
 2000
- 2001
2000
- 2001
Invités:
B.Miège
D.Dayan
Y.Winkin
Ph.Breton
 2001-
2002
2001-
2002
Invités :
M. Robitaille
M. Diklic
Mme. Gabay
M. Jeanneret
 CONFERENCES
INFOCOM 1999-2000
CONFERENCES
INFOCOM 1999-2000
 Haut
Haut
-
Intervention de Daniel Bougnoux
- vendredi 26 mars 1999
La médiologie
: cadrer et regarder quelque-chose qui paraît déjà
familier. L’homme qui parle est pris par la linguistisue, la psychanalyse,
le rêve,
Qu’est-ce que transmettre
? On a l’idée de transmission, de génération, d’un
avant et d’un après. Alors que dans la médiologie, l’idéologie
de la transmission diffère de celle de la communication. La première
est reliée au leg symbolique dans le temps, elle est diachronique.
La seconde est synchronique, c’est de la communication en direct, on a
une maîtrise de l’espace.
La transmission est ancienne
(homo erectus et le silex biface, transmission des outils à sa progéniture),
mais comment est-elle possible ? C’est la question de la culture qui est
posée, celle de l’homminisation. Les animaux ne transmettent pas
d’héritage acquis. par quelles ruses techniques, par quels outils,
le temps est-il cumulatif ? Les outils sont façonnés par
l’homme, mais ils façonnent l’homme aussi.
Quelle est la condition de
tout acte de transmission ? Les SIC doivent creuser cette profondeur temporelle.
Les documents, les témoignages de vie passés, sont class
és comme des documents. On a une crispation sur la mémoire.
Les lieux de mémoire (Nora), la politique de la mémoire,
le gouvernement du tamps, toutes ces notions sont à relier avec
des questions politiques. L’inscription, l’enracinement, relèvent
de la gestion du symbolique.
La question de la culture
Il y a une différence
entre la conception de Sperber et celle de Debray. Sperber a une vision
naturaliste de la culture, il parle de contagion, de propagation de virus
qui poirrait être assimilée à la propagation des idées.
Cela rejoint l’américanisme de Leroy-Gourant. Debray adopte lui
une perspective plus historique, et refuse de biologiser l’histoire humaine.
La transmission symbolique et ses outils comptent, contrairement à
ce qui se retrouve chez Sperber, dans son ouvrage " La contagion des idées
" (Odile jacob). Debray parle de contagion, de propagation de formes et
d’idées, la culture serait ce qui permettrait la transmission. C’est
une vision culturaliste et anthropologique, opposée au biologique.
Comment surmonte-t-on l’animalité
? L’homminisation, c’est articuler plus que disjoindre les notions de naturalisme
et de sociologisme.
La médiologie est
vue comme une transmission. Quels sont les outils de l’homminisation ?
On peut penser que les tombes, les tumulus, les dolmen, sont les premiers
vestiges émouvants de la mémoire des hommes. La sépulture
est une ressource d’observation inépuisable, un acte culturel par
excellence. Il s’agit du marquage de l’espace par le temps.
L’axe 1 : le temps
de la transmission.
L’axe 2 : la conquête
de l’ubiquité ou l’espace de la communication, la maîtrise
de l’espace, le passage du qualitatif au quantitatif. La communication
: standardiser ce qui se vit dans la quantité pure, rendre l’espace
isomorphe et standardisé. Comment rend-on l’espace circulable ?
Qu’est-ce qu’une route ? Les animaux se déplacent de A à
B mais n’ont pas de route réellement. La route n’est pas le trajet,
elle est bi-directionnelle, on peut revenir au point A.
L’information s’est détachée
des supports musculaires et animaux. Les messages se sont détachés
de la vitesse musculaire. Ex.: le télégraphe optique, début
19ème, était le premier moyen de découpler l’information
des corps matériels en mouvement. Dématérialisation
des messages, les messages transmis sont de plus en plus immatériels.
Les routes étaient des espaces de plus en plus aléatoires.
La route de la soie, avec les légendes, les lettres qui arrivaient
trop tard, la rumeur, etc. On a perdu l’idée d’insécurité
des routes. On a aussi l’idée d’interopérabilité des
médias.
La standardisation des médias,
de la culture, ouvre la diversité des messages. On a donc une multiplicité
des routes qui n’encourage pas l’uniformisation des messages. C’est une
conquête ubiquitaire de l’espace. Le temps du récit s’exerçait
dans la graphosphère.
1450 - 1950 : la culture
est dominée par la performance livresque, ls hommes politiques sont
toujours avides d’écriture. C’est une manière de capitaliser
symboliquement leur autorité. Ce qui était fondé sur
le récit et le différé du livre a disparu. L’image
est aujourd’hui perçue différemment. Le choc du livre (graphosphère)
et de l’image (vidéosphère) apparaît. Des couches sémiotiques
différentes apparaissent, on a des traitements différents
de l’information.
Il faut composer en pensant
que " ceci ne tuera pas cela ", que l’écran ne tuera pas le lisible.
Leur coexistence doit être
encouragée. On a une friction, un chic entre la graphosphère
et la vidéosphère. Le travail de la communication est de
mieux évaluer les ressources symboliques, l’histoire de ces affrontements.
La religion figurative et la religion iconoclaste. On voit que ces questions
ont travaillé notre histoire culturelle.
c’est une affaire de complémentarité
et de contradiction. Il faut que le monde aboutisse à un livre,
pensait Mallarmé. L’écran donne des images, des textes, des
sons, on a une matrice pour le savoir. l’écran est devenu le lieu
de mémoire. On a une critique du logo-centrisme qui foncde la graphosphère,
c’est-à-dire que le langage est la base de la culture respectueuse.
Le reste serait dégressif : les indices, les images, ces couches
sémiotiques réputées moins bonnes.
D’autres formes de mémoire
existent aujourd’hui. Qu’est-ce qu’un livre ? Le hommes ont dit le monde
grâce à cette forme froide typographique.
L’ordre de l’abstraction
du livre fait que l’on est craintif devant l’interactivité : " un
livre est un lieu où les mots sont en repos ".
dans le livre, tout est en
mouvement. Faut-il craindre cette activité ? " Ceci ne tuera pas
cela " (Hugo, Notre-Dame de Paris).
15ème siècle,
ironie : l’imprimerie était mal perçue. Le déclin
de l’analphabétisme. Le livre était associé à
la barbarie, en opposition avec les liens sociaux primaires.
Tu garderas l’énoncé
au plus près de l’énonciation, ouverture technique démocratique.
Détacher l’énoncé de l’énonciation, sinon,
on est dans une relation d’autorité. Le texte est toujours plus
fort.
Le direct, le différé,
dans la télécommunication
L’interactivité, le
retour à l’oralité, qui était avant pré-graphique.
Les médias se pensent entre eux. Les ruptures médiatiques
existent, si l’on sait par exemple que la photographie s’explique par l’invention
de l’imprimerie. Les ruptures sont au service de l’individualisme. On a
une privatisation des savoirs, un recul des anciennes communaiutés
organiques. Les schémas autoritaires reculent.
L’axe diachronique de la
transmision, culminant dans le graphisme
L’axe synchronique de la
communication, culminant dans les réseaux d’interactivité
directe.
Axe 1 : les outils
Axe 2 : les images,
le visuel
Or, on a une contradiction
entre raconter une histoire et regarder des images. On a une bifurcation
de la culture, quelque-choise de plus affectif, de moins syntaxique, de
plus global, les messages deviennent véhiculés par les images,
c’est moins analytique. Charnière de ce jeu image V. récit.
Paul Ricoeur et le récit
: on ne raconte plus l’histoire commme avant si on la dit par images ou
par CDRom. le déclin du roman n’équivaut pas à la
fin du récit. On a une pulvérisation du récit par
l’image, écrit JFLyotard, la postmodernité correspondrait
à la fin des récits.
Il y a toujours une perte
de sens dans la transmision. On se spécialise et on a de meilleures
contextualisations. On ne peut pas avoir le contexte de l’informationet
toute l’information. On est aux prises avec une forme. Les artistes sont
aux prises avec un filon, un pattern, en extension, et non en focalisation.
- La formule de Mac Luhan
" medium is message ".
On n’envoie pas le même
message sur des supports très différents. Le support est
caché par le message. Il y a du caché pour la médiologie,
ce caché c’est le média. On a un aveuglement vis-à-vis
des conditions d’acheminement du message, une fascination pour les performances
symboliques et culturelles.
On connaît par exemple
mieux l’histoire des guerre que celle de l’intendance, des armes. Même
chose pour la peinture, les oeuvres, vis-à-vis des aspects techniques
(ie pigments). Il n’y a de science que du caché. L’inconscient technqiue
existe. regardrer un film, c’est oublier le fait technique du film. Le
bon média travaille à se faire oublier.
S a -> S é
Lire c’est oublier la page
Le retour du signifié vers le signifiant est le média.
L’arrêt ur le média
est la médiologie.
Ce couple Signifiant / Signifié
sert dans les études structuralistes.
Le média comme message
est la base des études des relations dialectiques.
L’art : la teknè
L’autonomisation de l’art
est venue plus tard. A la Renaissance, on a des oeuvres signées
référées à des auteurs, la valeur artistique
se renforçait.
On a aujourd’hui un écrasement
de cette histoire de l’art. On voit quelque-chose de plus confus, autour
des nouvelles technologies. L’esthétique sépare pas le matériau
du message. Quand les signifiants comptent : c’est de la poésie.
" le hasard est vaincu mot par mot " : Mallarmé.
On ne peut pas comprimer
sur le plan esthétique.
Il n’existe pas de codes
qui permette d’élaguer le message. Un code structurant existe. L’invariant
du code peut redonner à un message sa plénitude communicative.
Dans l’oeuvre d’art, l’oeuvre
et elle-même son propre code. Point important pour la réflexion
dialectique mediumm / message.
Peirce : type / token
Le type de la langue permet
la reconnaissance du token. Chaque token est un type.
Le code est un élagage.
Le type n’est pas dégagé dans la photographie. Le dessin,
c’est mieux. Il extrait le type, ex: le champignon représenté
en photo ou en dessin. Par le dessin on essaie de nous donner du code.
La phot sera très élagante, individualisante. Il y a des
photos généralisantes, typifiantes, mais elles sont surtout
brouillantes. Le code, c’est l’archétype.
L’avenir est au léger,
au fluide, la pierre va chuter.
Une performance communicationnelle
passe par l’allègement croissant. On a une dématérialisation
des supports de messages.Un nouveau support. Les hommes de création,
les prophètes, ou les poètes reprennent leur rôle et
changent de support. Fin des grands efforts de l’humanité, de l’architecture
comme support. Le passage de la pierre au papier est le passage de l’immeuble
au meuble.
Le déterminisme
technologique :
changement de support signifie
changement de culture. Gutenberg en 1454 : Luther en 1521
Corrélation entre
technique et culture. Le facteur technique est toujours enchassé
dans une évolution plus large : les techniques se perfectionnent
mais les usages sont anciens. La technique est le compromis entre le vecteur
de nouveauté et des usages beaucoup plus vieux. Des milieux où
les NTIC arrivent, où on parachute des techniques, où on
a des transferts de technologie, sont sujets à fiasco parfois.
La relation pragmatique
différente de la relation technique.
Le sujet surplombe l’objet
dans la relation technique. Dans la relation pragmatique, on a une relation
de sujet à sujet. L’action pragmatique est donc aléatoire
(la praxis, l’action de l’homme sur l’homme). Cette relation sujet à
sujet enchasse. Il faut toujours du pragmatique pour contextualiser le
technique. On a une relation réverbérante, aléatoire.
Si on prend l’exemple de la conversation, personne ne la pilote totalement,
dans son ensemble. La communication, action de l’homme sur l’homme, ne
voit pas une action de l’homme sur la chose. La conversation est copilotée
horizontalement. Une relation pragmatique peut toujours échouer.
On interagit dans un processus plus large, on n’est pas maître à
bord.
C’est le primat de la relation
(Francis Jacques, coll Repères). Le " care ", relation Sujet à
Sujet, et le " cure ", relation Sujet à Objet.
Il ne faut pas rabattre les
relations intersubjectives sur des relations technique. Inversement, on
peut intervenir dans le psychologique avec de la technique.
L’idée de milieu
:
Il s’agit d’autorisation
plus que de détermination. Il y a une efficacité de la notion
de milieu. Une causalité existe dans la médiologie. Comment
un milieu agit-il ? la médiologie est une écologie. Un milieu
n’agit pas de façon linéaire (stimulus -> réponse).
On peut isoler les causalités négatives plus que celles positives.
La causalité est négative. Si on n’a pas tel facteur technique,
alors on n’aura pas tel effet. C’est du déterminisme ravageur. Les
rapports écologiques entre telle infrastructure et telle structuration
de la société existent.
Jack Goody : absence de société
orale dans l’Afrique de l’ouest. Une tradition d’accumulation critique
dans l’histoire scientifique. La question des supports, de l’inscription
est importante. En conclusion, on peut dire que la condition est nécessaire
mais n’est pas suffisante.
socialisme // typographie,
19ème siècle:L’idée de transmettre.
Debray réfléchit
à la question du monothéisme : pourquoi a-t-on une religion
monothéiste ? Cela est lié à la mobilité des
égyptiens qui sont passés d’une civilisation agraire à
une tradition plus nomade, la tora a remplacé les statues des dieux
polychrones. Le monothéisme est donc venu des contraintes imposées
aux voyageurs.
On constate donc que des
petites causes techniques peuvent avoir de grands effets civilisateurs.
Le monothéisme est lié à la contrainte de la sédentarité.
5 - L’efficacité
symbolique
Qu’est-ce qui fait que des
oeuvres se diffusent ? Comment une idée fait-elle corps ? Quelle
est la vérité intrinsèque du message ? Si toute science
naît de l’étonnement, alors il y a un étonnement médiologique.
Les missionnaires et la propagation
de la foi.
La rétro-position
de l’origine compte. JC rétroposé par les premiers conciles.
Invention de l’histoire sainte. ce sont les clercs qui fabriquent le vrai
après coup. La création d’un " isme " mérite toute
notre attention, il faut observer comment une idée change l’histoire.
Ex : le codex est substitué
au noumen
Le codex est le papyrus,
le bois, les planches, on peut indexer, pointer. C’est un régime
pauvre, mais en avence sur le plan technique. Le noumen, grand rouleau,
permet le repérage de textes, mais cette invention n’a aucun avenir.
Voir les écrits de
Maurice Suchot.
 CONFERENCES INFOCOM 2000-2001
CONFERENCES INFOCOM 2000-2001
 Haut
Haut
-
Yves Winkin, jeudi 22
février 15H00 à 18H00: " Anthropologie de la médiation
touristique "
-
Bernard Miège,
jeudi 1er mars 13H00 à 15H00: " Les industries du contenu "
-
Philippe Breton, jeudi
19 avril de 14H00 à 17H00: " Le culte d’internet "
-
Daniel Dayan, jeudi 10
mai de 14H00 à 17H00: " Les cérémonies télévisuelles
"
-
BERNARD
MIEGE - " Les industries du contenu face à l’ordre informationnel
"
Jeudi 1er Mars 2001 de
13H00 à 15H00, AMPHI L 1 (Bâtiment du pôle langues)
Les industries du contenu
- ou les programmes - sont, avec les réseaux et les outils (ou matériels)
de communication, l’une des trois composantes des " industries de la communication
". L’avenir de celles-ci, comme on s’accorde le reconnaître, dépend
largement de la capacité des firmes, grandes et petites, à
industrialiser des services.
Ce procès est engagé,
car les " modernes industries du contenu ", pour une bonne part, sont en
continuité avec les industries de la culture, de l’information ou
avec des médias de masse, dont elles reprennent plus ou moins les
règles de fonctionnement spécifiques, formées depuis
un siècle et plus.
Pour éclairer les
enjeux très actuels de l’industrialisation de l’information et de
la culture, il faut faire un retour sur des modalités connues et
déjà expérimentées, comme l’édition
ou le " flot ", auquel les médias de masse nous ont accoutumés.
L’accès à la
musique enregistrée en ligne, les licenciements chez Amazon.com
ou le contrôle de Universal par Vivendi: des interrogations bien
actuelles qui ont toutes à voir avec la question des industries
de la culture et de l’information.
Bernard Miège est
professeur de sciences de l’information et de la communication à
l’université Stendhal Grenoble 3, et dirige le laboratoire de recherche
GRESEC.
-
PHILIPPE BRETON, "Les mythes
de l’Internet" Jeudi 19 avril 2001 de 14H00 à 17H00, AMPHI
FEUILLERAT
-
DANIEL DAYAN, "Les cérémonies
télévisuelles" Jeudi 10 mai 2001 de 14H00 à
17H00, AMPHI L1
-
YVES
WINKIN - " Anthropologie de la médiation touristique "
Jeudi 22 février 2001
de 15H00 à 18H00, AMPHI L 3 (Bâtiment du pôle langues)
La " communication interculturelle
" est à la fois un objet et un champ de recherche. Pour en parler
concrètement, je voudrais me concentrer sur une forme de communication
interculturelle, celle qui structure les relations entre " touristes "
et " hôtes ". Le discours courant dira qu’il n’y a pas de communication
entre les touristes et les acteurs locaux -sinon quelques bribes de conversation
avec divers marchands de " souvenirs ". A la fois pour des raisons empiriques
et théoriques, je me propose de prendre à rebrousse-poil
cette assertion facile. Je m’appuierai sur une présentation du film
de Dennis O’Rourke, Cannibal Tours, pour amorcer une réflexion
sur le rôle du guide touristique, qui est moins un " médiateur
" qu’un " cadreur ", c’est-à-dire un expert qui fixe les " cadres
d’expérience " (Goffman) offerts aux touristes. L’expérience
touristique peut ainsi être envisagée comme une " willing
suspension of disbelief " (Coleridge). Comme une tentative de réenchantement
du monde. La suite à l ’écran.
Références:
-
Yves Winkin, " Le touriste et
son double ", in Anthropologie de la communication, Bruxelles, De
Boeck, 1996; Paris, Le Seuil, 2001, coll. Points.
E.Goffman, Les cadres
de l’expérience, Paris, éd. de Minuit, 1001.
 CONFERENCES
INFOCOM 2001- 2002
CONFERENCES
INFOCOM 2001- 2002
 Haut
Haut
Invités :
-
M.ROBITAILLE
-
M.DIKLIC
-
MME.GABAY
-
M.JEANNERET
-
René Robitaille,
" L’internet et la publicité ", 06 décembre 2001, présentation
des travaux du québécois
-
R. Diklic, " Médias
et politique - le rôle des médias en période de crise"
Jeudi 31 Janvier 2002, de 14H00 à 16H00
Monsieur R.Diklic est actuellement
ambassadeur de la République Fédérale de Yougoslavie
à Paris.
Mr.Diklic, ambassadeur depuis
un an, était auparavant le fondateur et le directeur d'une agence
de presse indépendante du pouvoir politique, Beta, dont les résumés
de nouvelles étaient accessibles par Internet, permettant ainsi
à un public assez large l'accès, y compris pendant la guerre
de 1999, à une information autre que celle délivrée
par les médias sous contrôle du pouvoir politique.
-
Michèle Gabay,
qui vient d’écrire un ouvrage consacré aux problématiques
de communication de crise, publié chez Elsevier